30 janvier 2024 | Blog, Blog 2024, Communication | Par Christophe Lachnitt
La Trumperie continue
2024 est l’année de tous les dangers pour l’Amérique et, avec elle, le monde.
Mes incursions dans la politique internationale procèdent de ma passion pour ces sujets qui, pour reprendre une formule célèbre, ne me sont pas totalement étrangers, ayant conseillé il y a quelques décennies un futur Président de la République française pendant plusieurs années à leur propos. Loin de constituer un argument d’autorité, cette expérience motive simplement les digressions sur la géopolitique que je me permets dans ce blog, bien qu’il ne lui soit pas consacré. – Christophe Lachnitt
Les deux primaires qui ont eu lieu ces derniers jours en Iowa puis au New Hampshire sont représentatives de la complexité du système électoral présidentiel américain (élection au suffrage universel indirect par les 538 grands électeurs des 50 Etats) et de l’illisibilité prédictive du scrutin de cette année qui devrait une nouvelle fois se jouer dans quelques Etats-pivots (“swing states” ou “battleground states”).
L’Iowa est un Etat solidement républicain que Donald Trump avait remporté avec dix points de pourcentage d’avance sur ses adversaires démocrates en 2016 (Hillary Clinton) et 2020 (Joe Biden). Le caucus de l’Iowa ne mobilise qu’une infime partie de l’électorat de l’Etat : 110 000 électeurs – les républicains les plus fervents – y ont participé cette année, alors que plus de 1,5 million avaient voté lors de la présidentielle de 2020. Le New Hampshire, en revanche, est moins monotone, même si les démocrates y ont prévalu lors des présidentielles depuis 2004. Récemment, Joe Biden a remporté cet Etat avec sept points de pourcentage d’avance et Hillary Clinton avec moins d’un demi-point. Il s’agit d’un Etat gagnable par un républicain en raison du nombre des électeurs indépendants (ceux qui ne s’identifient ni comme démocrates ni comme républicains). D’ailleurs, 46% des électeurs de la dernière primaire républicaine en date étaient indépendants. Or, même s’il l’a emportée haut la main face à Nikki Haley avec plus de 50% des voix, Donald Trump l’a perdue de 30 points chez les indépendants, alors que, mutatis mutandis, il doit améliorer sa performance auprès d’eux au niveau national par rapport à la présidentielle de 2020. Même au sein de son parti, les perspectives de Donald Trump ne sont pas totalement prometteuses : 21% des républicains qui ont voté à la primaire dans le New Hampshire ont déclaré qu’ils seraient tellement insatisfaits de la désignation de Donald Trump pour la présidentielle qu’ils ne voteraient pas pour lui. Mais il n’en va pas forcément de même dans tous les Etats qui joueront un rôle critique le 5 novembre prochain. A ce stade, Donald Trump est assuré, sauf péripétie judiciaire peu probable ou accident de santé peu prévisible, d’être le candidat républicain à la Maison-Blanche. Son succès lors de ce scrutin n’est pas garanti mais il est plausible, et ce malgré sa situation judiciaire unique dans l’histoire américaine.
Il doit en effet répondre de 91 chefs d’accusation dans le cadre de quatre affaires pénales. Il soutient devant de nombreux tribunaux que, en vertu de son statut d’ancien Président, il est à l’abri des lois en fonction desquelles les autres Américains sont gouvernés et potentiellement jugés. Si cette galéjade était vraie, je me demande pourquoi Gerald Ford aurait pris la peine de gracier Richard Nixon. Le seul fait qu’elle fasse l’objet d’un débat politique et juridique intense outre-Atlantique montre à la fois l’imprécision de certains textes rédigés par les Pères fondateurs et le dérangement mental dans lequel Donald Trump a plongé son pays à dessein : la perte de repères qu’il lui impose est son repaire. En réalité, la section 3 du quatorzième amendement de la Constitution interdit à quiconque a prêté serment en tant qu’officier du gouvernement, puis a pris part à une insurrection, d’occuper une fonction gouvernementale fédérale ou dans un Etat : “Nul ne sera sénateur ou représentant au Congrès ou électeur des Président et Vice-Président ni n’occupera aucune charge civile ou militaire du gouvernement des Etats-Unis ou de l’un quelconque des Etats qui, après avoir prêté serment comme membre du Congrès ou fonctionnaire des Etats-Unis ou membre d’une législature d’Etat ou fonctionnaire exécutif ou judiciaire d’un Etat de défendre la Constitution des Etats-Unis, aura pris part à une insurrection ou à une rébellion contre eux ou donné aide ou secours à leurs ennemis. Mais le Congrès pourra, par un vote des deux tiers de chaque Chambre, lever cette incapacité“1.
Au-delà de ces sophismes constitutionnels, ce sont les trois branches du gouvernement américain qui sont malades.
L’institution faîtière de la branche judiciaire est corrompue dans sa composition comme dans son fonctionnement. Sa majorité conservatrice résulte, comme je l’avais souligné à l’époque, de la suprêmement malhonnête manipulation dont Mitch McConnell, le patron des sénateurs républicains, fut l’auteur pour faire en sorte qu’un siège revenant à un homme de loi nommé par Barack Obama fût finalement attribué à un juriste désigné par Donald Trump. Le dysfonctionnement de la Cour, digne d’une république bananière, procède notamment des méfaits de Clarence Thomas, nommé en son sein en 1991 malgré les lourdes accusations de harcèlement sexuel qui pesaient sur lui, et de son épouse Ginni : Clarence reçoit de très importants cadeaux de la part de milliardaires concernés par des décisions de la Cour. Ginni, pour sa part, a soutenu | l’insurrection | du 6 janvier 2021 et donc la destruction de la Constitution que son mari est censé défendre. Elle a également été rémunérée par une personne qui présentait des affaires devant la Cour suprême. Et, pourtant, Clarence ne se récuse dans aucun des dossiers traités par la Cour à ces sujets et n’est pas contraint de le faire.
La branche législative n’est pas en meilleur état, comme l’ont montré les deux procédures de destitution de Donald Trump en 2019 (chantage sur le Président ukrainien) et 2021 (insurrection du 6 janvier) et la domination sans partage qu’il exerce toujours sur son parti au Congrès.
Quant à la branche exécutive, elle court d’importants risques, que Donald Trump reprenne ou pas possession du Bureau ovale : dans les deux cas, il ira beaucoup plus loin qu’il ne le fit en 2017-2020 s’il est élu ou qu’en 2021-2024 s’il est battu. Dans la première hypothèse, l’insurrection du 6 janvier ne serait qu’un avant-goût improvisé d’une action beaucoup plus structurée et violente à laquelle la probable faible marge de la victoire de Joe Biden (quelques dizaines de milliers de voix d’écart dans quelques Etats-pivots) conférerait une grande légitimité aux yeux de ses protagonistes. Dans le second cas, Donald Trump pervertirait les principes démocratiques et républicains de l’Amérique pour mettre l’Etat à son service et réaliser son désir de se venger contre les cadres de sa première administration qui, estime-t-il, l’ont trahi, les membres des services judiciaires et de sécurité qui ont enquêté à son sujet, les élus qui ont voté en faveur de sa destitution, toutes les personnes qui ont refusé sa fable de l’élection volée de 2020, ses opposants démocrates et les médias qu’il juge hostiles. Il a par exemple exprimé publiquement son envie de traduire en justice de supposés ennemis – l’ancien chef d’Etat-Major des Armées Mark Miley qu’il voudrait voir condamné à mort et exécuté ou le groupe de médias Comcast, propriétaire des chaînes de télévision NBC et MSNBC.
Aux trois branches du gouvernement s’ajoute le Quatrième pouvoir qui s’est évertué, depuis l’insurrection du 6 janvier 2021, à normaliser Donald Trump et ses séides de même qu’il leur avait fait la courte échelle en 2015-2016. J’écrivais à ce sujet en août 2016 : “la campagne de Trump a été plus couverte par l’ensemble des médias que n’importe quelle candidature politique de l’Histoire (elle a bénéficié de l’équivalent de 3 milliards de dollars de présence gratuite sur les médias américains) parce qu’elle est plus divertissante, spectaculaire et, en un mot, addictive que celles de ses rivaux républicains et Hillary Clinton“. J’ai déjà détaillé sur Superception l’approche que les médias américains auraient dû adopter s’ils avaient voulu exercer leur mission au service des valeurs démocratiques plutôt que d’être obsédés par une création de valeur démonique.

Dans ce contexte de déliquescence des principales institutions américains, Donald Trump aurait, s’il était de nouveau élu, beaucoup plus de pouvoir que lors de son premier mandat car il ne serait plus entouré d’”adultes” encadrant ses foucades : son équipe pré-recrute plus de 50 000 potentiels membres de son administration sur les seuls critères de la loyauté et de l’engagement à repousser les limites des pouvoirs accordés par la Constitution au Président. Leur déploiement représenterait une purge de grande ampleur de l’appareil d’Etat accusé depuis longtemps par Donald Trump d’être un “Etat profond”. En outre, les acteurs du système des poids et contrepoids (“checks and balances”) qui conditionne l’équilibre des pouvoirs ne pourraient certainement pas le contrôler un fois redevenu Président, alors qu’ils n’ont pas réussi à le maîtriser quand il était simple citoyen puis candidat, et ce malgré ses 91 chefs d’accusation. Certes, il ne faut pas s’attendre à voir l’Amérique verser dans un régime totalitaire mais un scénario hongrois, avec une réduction d’un grand nombre de libertés individuelles et collectives, est assez vraisemblable pour être redouté. Si, dès lors, des révoltes se levaient contre cette forme de gouvernement, nous savons déjà que Donald Trump n’hésiterait pas, pour protéger son pouvoir, à faire jouer l’Insurrection Act de 1807 qui permet au Président américain, dans des circonstances spécifiques auxquelles il ne se limiterait bien sûr pas, de déployer l’armée pour mettre fin à des troubles submergeant les autorités civiles. Il a lui-même admis qu’il gouvernerait comme un dictateur “seulement le premier jour” de son second mandat, une assertion qu’il serait malavisé de ne pas comprendre comme le début d’une préparation des Américains à une dictature bien plus durable. De même que des Etats ultra-républicains pourraient être tentés de s’éloigner du système fédéral si Joe Biden était réélu, des Etats démocrates pourraient considérer une forme de sécession si Donald Trump concrétisait ses inclinations anti-libérales. Une telle évolution représenterait un risque de violence considérable, une perspective préoccupante dans un pays qui compte tant d’armes à feu en libre circulation (120,5 pour 100 résidents).
Ce risque de violence est nourri par le rôle démesuré que jouent de nouveau les enjeux identitaires ethniques en Amérique, dont ils ont à plusieurs reprises terni l’Histoire. Dans une recherche consacrée à ce sujet, Nicholas A. Valentino et Kirill Zhirkov, deux politologues enseignant respectivement au sein des universités du Michigan et de Virginie, écrivent que “les partis américains sont de plus en plus considérés comme des camps raciaux et ethniques distincts, plutôt que comme des institutions chargées de mettre en œuvre des politiques uniques, ce qui a des implications majeures pour la compréhension des processus politiques actuels aux Etats-Unis“. La polarisation qui résulte de cette situation bénéficie à Donald Trump car, pour la majorité, les électeurs républicains détestent davantage les démocrates qu’ils ne méprisent ou craignent leur propre candidat.
Pour autant, il faut aussi considérer que l’écrasante majorité de républicains convaincus que l’élection de 2020 a été volée par Joe Biden2 n’ont pas fait acte de violence, ce qui montre soit leur pusillanimité soit le caractère dissuasif des peines prononcées à l’encontre des insurrectionnistes du 6 janvier 2021.
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche n’aurait pas des effets dramatiques qu’aux Etats-Unis. Parmi ses conséquences géopolitiques, le retrait américain, partiel ou total, de l’OTAN aurait des répercussions majeures, alors même qu’un nouvel axe du mal constitué, malgré leurs différences d’intérêts, de la Chine, la Corée du Nord, l’Iran, la Russie et leurs affidés (groupes terroristes, partis politiques extrémistes dans les pays occidentaux…) s’évertue à déstabiliser le monde libre sur les plans politique, militaire, financier et culturel. Donald Trump a menacé durant son premier mandat d’extraire l’Amérique de l’OTAN, le plus fameusement lors du sommet de celle-ci en 2018. Alors, plusieurs membres de son administration (John Bolton, John Kelly, Jim Mattis, Mike Pence, Mike Pompeo, Rex Tillerson…) s’opposèrent à cette décision. Demain, s’il était de nouveau élu, il ne serait plus entouré que d’hommes liges. A cet égard, pour reprendre le propos de John Bolton, son ancien conseiller à la sécurité nationale, l’OTAN ferait partie des domaines où “les dégâts qu’il a causés au cours de son premier mandat étaient réparables. Les dommages qu’il causeraient au cours du second mandat seraient irréparables”. Que ce retrait devienne effectif ou pas (il susciterait un lourd débat politique et constitutionnel au Congrès), la seule intention de Trump à son égard provoquerait une crise de confiance avec l’Europe… et la félicité de Vladimir Poutine qui y verrait un affaiblissement, voire un abandon, de l’article 5 du Traité de l’Atlantique nord qui prévoit la défense collective des membres de l’Alliance (“une attaque armée contre l’un ou plusieurs des membres en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque contre tous“). La dissuasion vis-à-vis des ambitions territoriales de la Russie poutinienne serait considérablement anémiée et la présence militaire américaine en Europe un tigre de papier. L’Europe se rendrait alors compte, comme je l’ai déjà souligné sur Superception, de ce qu’elle doit, géopolitiquement, militairement, financièrement et psychologiquement, depuis des décennies, au parapluie américain : “Si les Etats-Unis cessaient de défendre notre vieux continent, les pays européens devraient investir entre 280 et 350 milliards de dollars chaque année pour assurer leur autonomie sécuritaire et géopolitique. Autrement dit, une partie non négligeable de notre Etat-providence est subventionnée par les contribuables américains : le plan Marshall ne s’est pas arrêté au début des années 1950. Il s’est au contraire amplifié depuis lors“. L’arrêt du soutien américain à l’Ukraine, dans la même logique anti-Europe et pro-Poutine, ne serait que la première traduction concrète d’une stratégie aussi tragique que cohérente. Les alliés non-européens des Etats-Unis, malgré les réassurances de Donald Trump à l’égard de certains d’entre eux, se poseraient aussi des questions sur leur sécurité face à leurs voisins autocrates et/ou terroristes : la Corée du Sud, Israël, le Japon et Taiwan, en particulier, s’en trouveraient diminués.
Alors qu’ils sont au bord de l’abîme et risquent d’y entraîner le monde libre, force est de constater que les Etats-Unis – les électeurs bien sûr mais aussi les leaders républicains, le ministre de la Justice de Joe Biden, les décideurs économiques et les médias – n’ont pas pris les décisions qui s’imposaient pour prévenir la résurgence et le possible retour au pouvoir de Donald Trump. Ce dernier fait peur à tous ceux qui devraient se mettre en travers de sa route parce qu’il ne met aucune limite à la protection de son intérêt personnel et que ses supporters les plus exaltés sont prêts à la violence contre ses opposants internes au camp républicain. Celui-ci est donc plus uni, même artificiellement, derrière lui que ne l’est le Parti démocrate derrière Joe Biden, lequel ne dispose pas non plus d’une armée de partisans aussi mobilisée que celle de son prédécesseur. En outre, Donald Trump propose, comme Adolf Hitler en son temps, des solutions simplistes aux problèmes profonds dont souffrent les Etats-Unis. Il ne s’agit pas de les comparer, même si le premier a fait des références plus ou moins voilées au second, mais de souligner l’attrait d’un autocrate dans un pays qui doute de lui-même comme l’Allemagne de Weimar ou l’Amérique actuelle : le rejet des conventions civiques et des règles constitutionnelles pour sortir un Etat de sa déchéance est une offre politique qui suscite parfois l’adhésion. Donald Trump ne serait pas le premier dictateur à parvenir démocratiquement au pouvoir. A cet égard, malgré qu’il ait déjà exercé le pouvoir quatre ans, il a réussi à se repositionner comme le candidat antisystème face au système incarné depuis 50 ans par Joe Biden (qui fut élu pour la première fois au Sénat des Etats-Unis en 1973). Il faut dire que ses électeurs n’attendent pas tant de Donald Trump des réalisations concrètes, qu’il a échouées à délivrer, à l’exemple de la construction de son mur à la frontière sud du pays, mais la guerre politico-culturelle contre leurs adversaires dans laquelle il excelle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les déboires judiciaires du républicain l’aident : ils confirment aux yeux de ses supporters son statut de martyr du système de pouvoir américain en leur nom.
Aujourd’hui, Joe Biden, sur les épaules duquel reposent tant d’enjeux, n’est pas dans une position des plus favorables. En premier lieu, 77% des Américains le jugent trop vieux pour effectuer un nouveau mandat contre “seulement” 51% qui expriment cette vue à l’endroit de Donald Trump, alors que les deux rivaux n’ont que quatre ans d’écart (81 ans contre 77). J’explique pour ma part cette étonnante différence de perception par le fait que la colère dont Donald Trump est le messager véhicule une posture plus énergisante que la raison dont Joe Biden est le héraut… et, plus prosaïquement, par le poids des ans plus visible sur le démocrate que sur le républicain, même si celui a récemment confondu Nancy Pelosi et Nikki Haley (excusez du peu). En outre, Joe Biden dispose de la deuxième plus basse cote de popularité des Présidents américains de l’ère moderne dans leur troisième année de mandat, une performance certes meilleure que celle de Jimmy Carter, qui détient le record en la matière, mais plus mauvaise que celle de Donald Trump3.
De son côté, ce dernier a recueilli 62 984 828 voix lors de la présidentielle de 2016 et, après l’avoir vu gouverner pendant quatre ans, 11,2 millions d’Américains supplémentaires (74 223 975) lui ont accordé leur confiance, ce qui rend compte de la crise nationale. Dans les Etats-clés du prochain scrutin présidentiel (Arizona, Caroline du Nord, Géorgie, Michigan, Nevada, Pennsylvanie et Wisconsin), le soutien à Donald Trump est “remarquablement stable” : depuis 2016, ses résultats ont varié au maximum de quatre points. C’est à la fois une force mais aussi une relative faiblesse car la fragilité (politique) de Joe Biden aurait dû permettre à son rival de mieux performer dans les sondages dans ces contrées depuis 2020, ce qui n’a pas été le cas. En outre, ses perspectives électorales s’amenuisent dans le cas où il serait reconnu coupable dans l’une de ses affaires judiciaires d’ici le scrutin présidentiel : 26% des républicains traditionnels et 31% des indépendants affirment, du moins aujourd’hui, qu’un tel événement réduirait leurs chances de voter pour lui.
Au final, l’élection du 5 novembre prochain est donc aussi ouverte que son issue risque de fermer toute perspective positive à l’Amérique et la planète.
—
1 “No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability.“
2 Seulement 31% des républicains estiment Joe Biden élu régulièrement. A l’échelle de l’ensemble de la population, ce sont pas moins de 36% des Américains qui considèrent que leur Président n’est pas légitime.
3 Il est difficile de dire si la répugnante candidature de Robert F. Kennedy Jr. va davantage affaiblir Biden ou Trump en novembre.


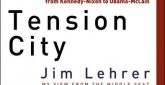

Fidèle lecteur de ce blog, votre article me rappelle votre analyse avant l’élection de Trump en 2016. Clinton était la pire candidtae démocrate, la seule qui pouvait perdre face à Trump.
L’histoire se répète, il me semble que Biden (81 ans) est le pire candidat démocrate.
C’est désolant.